
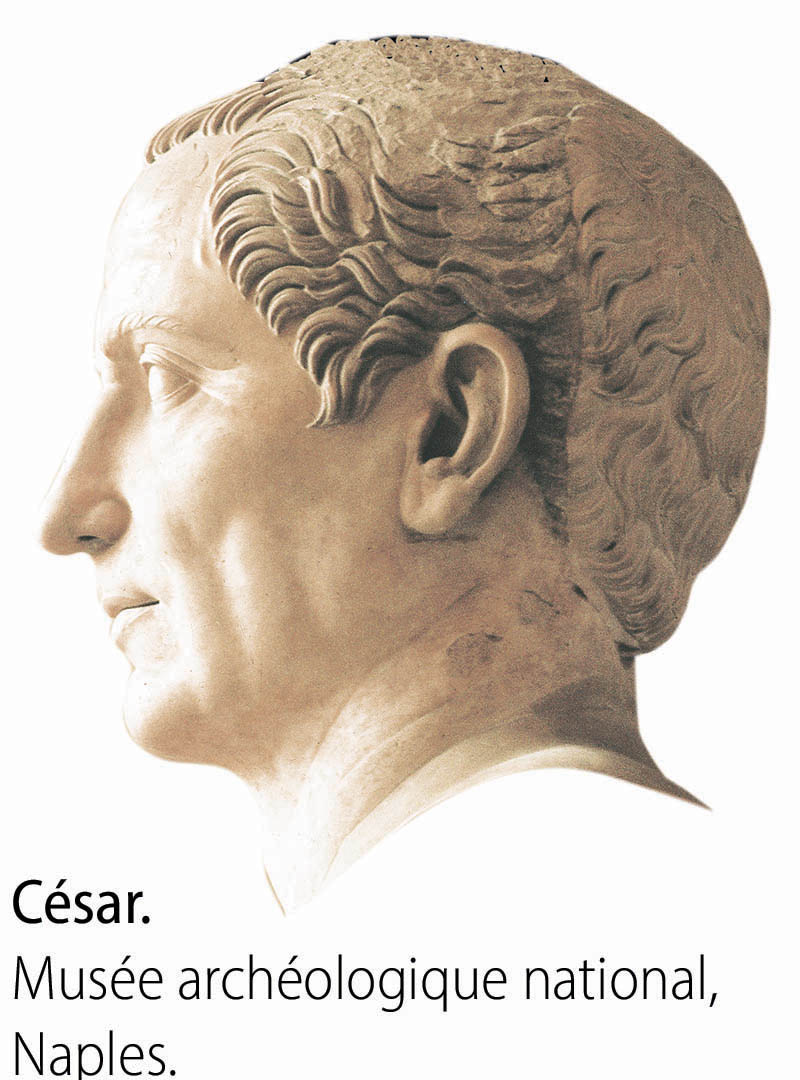
Issu d'une famille patricienne, il s'oppose au dictateur Sulla (qui lui a demandé de répudier son épouse, fille de Cinna) et s'exile en Asie (82-78). Il entreprend ensuite une carrière politique, profitant des milieux d'argent (Crassus) tout en s'appuyant sur le parti populaire, seule force capable de briser le sénat et Pompée. Questeur en 68, préteur en 62, il devient aussi grand pontife (la plus haute autorité religieuse) en 63. Après une campagne facile en Espagne (61-60), il propose à son bailleur de fonds, Licinius Crassus, et à Pompée de constituer un triumvirat (60). Consul en 59, il s'assure l'appui de la plèbe en faisant voter deux lois agraires qui achèvent de partager les terres du domaine public entre les plus pauvres. En 56, César renouvelle le premier triumvirat pour cinq ans et obtient un nouveau commandement. Il conquiert la Gaule de 58 à 51, égalant ainsi la gloire militaire de Pompée. Il tire de la guerre des Gaules un immense prestige habilement entretenu par ses Commentaires. Désormais, les frontières de l'État atteignent le Rhin. En 53, Crassus est tué en Orient durant une campagne contre les Parthes. Le triumvirat n'existe plus. En 52, Pompée, nommé consul unique par le sénat, exige du conquérant des Gaules de rentrer à Rome en simple citoyen. Ne pouvant obtenir de garantie, César franchit le Rubicon, frontière entre l'Italie et la Cisalpine, et marche sur Rome (janv. 49). Surpris, Pompée s'enfuit en Grèce pour y former l'armée républicaine. Maître de l'Italie (janv.-févr. 49), vainqueur en Espagne (août), César écrase Pompée à Pharsale (48), le poursuit en Égypte où ce dernier est assassiné par le roi Ptolémée Aulète. César installe sur le trône d'Égypte la reine Cléopâtre et, s'assurant ainsi un solide protectorat, réorganise l'Orient (47). Il vainc les derniers pompéiens en Afrique à Thapsus (46), puis en Espagne à Munda (45). Maître absolu du Nord romain, César exerce son pouvoir dans un cadre légalement républicain. Il se fait octroyer soit la dictature (49 et 47), soit le consulat (48 et 46), soit les deux fonctions en même temps (45 et 44), détenues d'abord à temps limité (dix ans en 46), puis à vie (44). Il détient en outre les pouvoirs d'un tribun de la plèbe (44). Le sénat ne cesse d'élargir ses pouvoirs : droit de paix et de guerre, droit de créer des patriciens, de nommer les consuls et la moitié de tous les autres magistrats, de promulguer des décrets ayant force de loi. Pour conserver l'appui du peuple, il multiplie les fêtes et fonde, en faveur de ses vétérans et des prolétaires, des colonies romaines en Narbonnaise et sur les sites de Corinthe et de Carthage. Le pouvoir du sénat et celui des comices sont diminués. En multipliant le nombre des magistrats, il affaiblit leur autorité. Il réforme le calendrier. Enfin, il accorde le droit de cité à de nombreux provinciaux, surtout en Gaule. Dictateur à vie, César sans doute souhaite le pouvoir royal. Une conspiration se noue entre mécontents et partisans de la République, dirigée par Cassius et Brutus ; César est poignardé en plein sénat, le jour des ides de mars (15 mars 44). Il a laissé des Mémoires, Commentaires sur la guerre des Gaules et sur la guerre civile (De bello gallico, De bello civili).