
nom féminin
(lat. aqua)

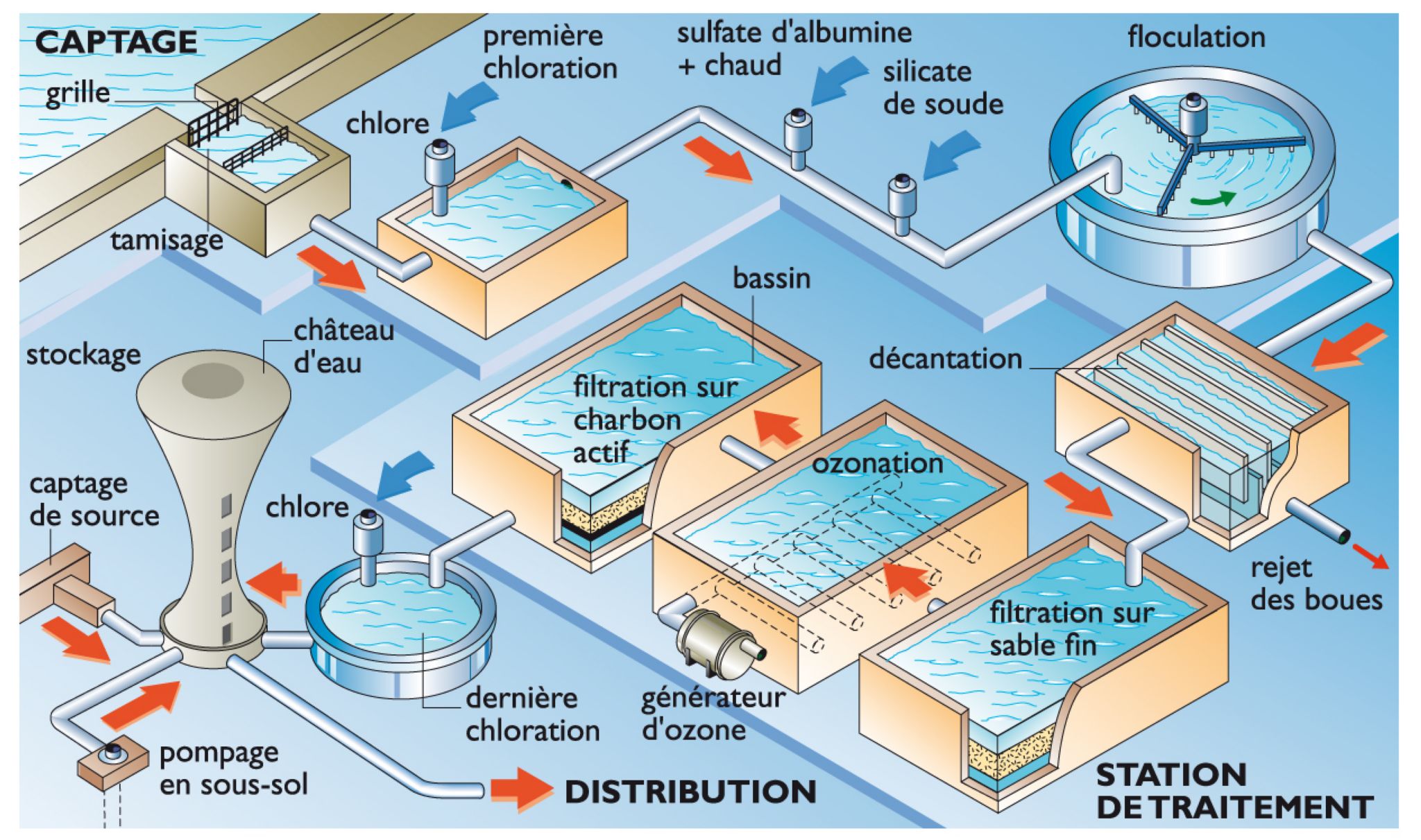

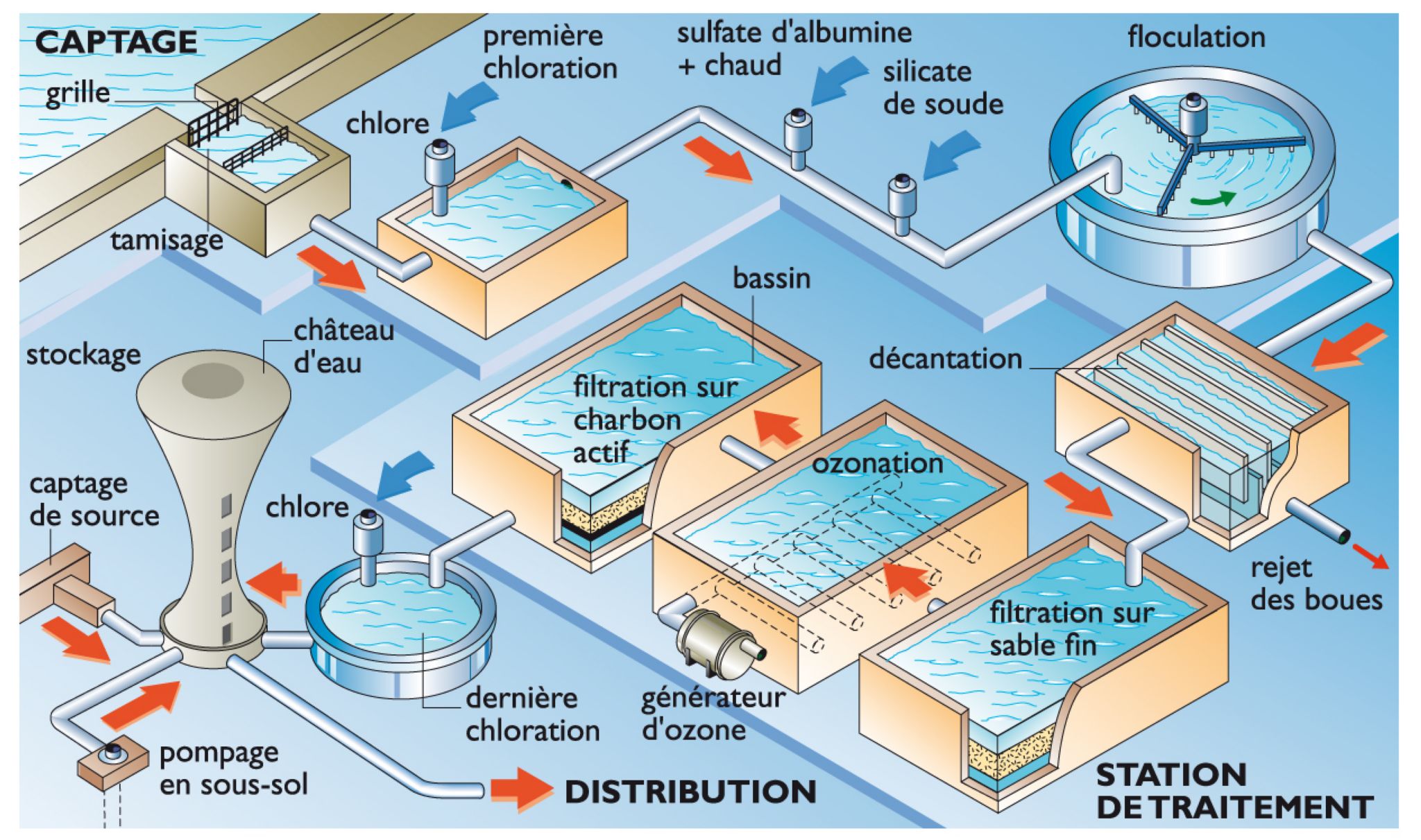
Faire eau, se remplir d'eau accidentellement, en parlant d'un navire.
Mettre de l'eau dans son vin, modérer ses exigences, ses projets, etc.
Eau de Seltz, eau gazeuse acidulée, naturelle ou artificielle.
Eau de toilette, préparation alcoolique dérivée d'un parfum dont le degré de concentration est intermédiaire entre l'extrait et l'eau de Cologne.
nom féminin pluriel
DROIT Eaux territoriales, zone maritime fixée par chaque État riverain (12 milles marins pour la France) et sur laquelle il exerce sa souveraineté (on dit aussi mer territoriale).
GÉOGRAPHIE Basses eaux, hautes eaux, niveau le plus bas, le plus haut d'un fleuve, à une période de l'année qui varie selon le régime.
Dans l'Antiquité, l'eau était considérée comme l'un des quatre éléments fondamentaux de l'Univers avec le feu, l'air et la terre. Cette conception postulait notamm. que, longuement chauffée dans un vase, l'eau se transformait en terre pour une petite part. Elle perdura durant tout le Moyen Âge. Au XVIIIe s., A. Lavoisier montra que le résidu terreux provenait en fait du vase et non de l'eau. En 1785, à la suite de H. Cavendish, qui constata que la combustion de l'hydrogène provoque la formation de gouttelettes d'eau, Lavoisier réalisa en public une expérience d'analyse et de synthèse de l'eau, prouvant ainsi qu'elle n'est pas un corps simple. En effet, il s'agit d'une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Elle a pour formule H2O.
Propriétés de l'eau.
Liquide incolore, transparent sous faible épaisseur, mais prenant une teinte vert-bleu sous grande épaisseur, inodore, sans saveur, l'eau présente diverses particularités physiques. Entre 4 °C et 0 °C, son volume augmente quand la température baisse, au contraire des autres liquides. La densité de l'eau (voisine de 1) est maximale à 4 °C. L'eau est donc plus dense que la glace (densité : 0,92), ce qui explique, notamment, que les icebergs flottent sur les océans. L'eau dissout un grand nombre de substances solides, liquides ou gazeuses. Ainsi, elle peut dissoudre le calcaire et le reprécipiter sous forme de stalactites et de stalagmites.
L'eau est un fluide qui change aisément d'état : sous la pression atmosphérique normale, elle gèle à 0 °C, donnant des cristaux hexagonaux, et bout à 100 °C, donnant de la vapeur. C'est un composé stable ; sa vapeur ne commence à se dissocier que vers 1 300 °C. Elle peut néanmoins être décomposée par les corps avides de l'un ou de l'autre de ses éléments constitutifs : le fluor, le brome ou le chlore fixent l'hydrogène et libèrent l'oxygène ; au contraire, le phosphore, le carbone, le silicium s'unissent à l'oxygène et libèrent l'hydrogène. Par ailleurs, l'eau donne de nombreux composés d'addition : hydrates ou complexes.
L'eau et les organismes vivants.
L'eau est le milieu de vie de tous les animaux ou plantes aquatiques, c'est-à-dire de la majorité des espèces. Elle constitue l'élément principal de toutes les cellules en état de vie active. Enfin, chez les êtres de grande taille, elle forme l'essentiel du liquide circulant (sève des plantes, sang des animaux). Chez l'homme adulte, l'eau représente environ 70 % du poids du corps.
L'eau dans le monde.
L'eau est sur la planète l'élément le plus répandu (1 360 millions de km3), dont la presque totalité toutefois est salée (95,5 %) ou contenue dans les calottes glaciaires ou les glaciers (2,2 %). Il reste donc 2,3 % d'eau douce utilisable, surtout dans le sol et le sous-sol, 130 000 km3 dans les lacs et les marais, de 13 000 à 15 000 km3 dans l'atmosphère et 4 000 km3 dans les cours d'eau. Le volume annuel des précipitations dépasse 500 000 km3, dont environ 100 000 km3 sur les continents.
À l'échelle de la planète, il ne peut y avoir de pénurie d'eau douce. En revanche, il existe dans de nombreuses régions des problèmes d'accès à l'eau douce, propre et potable. Plus de 1 milliard de personnes ne bénéficient pas d'un bon approvisionnement, et env. 2,5 milliards n'ont pas accès à un assainissement correct. L'accroissement de la population mondiale, l'intensification de l'agriculture (env. 70 % de la consommation mondiale d'eau) et de l'industrie conduisent à la surexploitation des réservoirs d'eau douce. De plus, les eaux douces sont souvent polluées par les engrais et les pesticides, les rejets industriels et les déchets domestiques.
On consomme en moyenne dans le monde 600 m3 d'eau par an et par personne, dont 50 m3 d'eau potable, soit 137 l par jour. Mais les disparités sont très fortes : un habitant des États-Unis consomme plus de 600 l par jour, contre 250 à 350 l pour un Européen et 10 à 20 l pour un habitant de l'Afrique subsaharienne. Les prélèvements peuvent être limités par le recours à la réutilisation des eaux (au Japon, la moitié de l'eau consommée provient de centres de retraitement des eaux usées). Enfin, des actions sont menées pour la mise en place de techniques d'approvisionnement alternatives : récupération de l'eau de pluie ou de l'eau présente dans l'atmosphère, désalinisation de l'eau de mer (une technique qui s'accroît globalement de plus de 10 % par an et qui représente, pour l'ensemble des pays du golfe Persique par exemple, la majeure partie de leur approvisionnement en eau potable).